Un Archipel des solidarités, issu d’un travail de terrain mené en Grèce entre juillet 2017 et janvier 2020 par la philosophe Christiane Vollaire et le photographe Philippe Bazin. Entretien avec Elias Jabre
Un Archipel des solidarités, Entretien avec C. Vollaire et P. Bazin
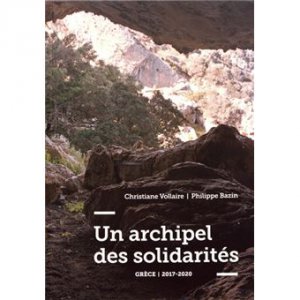
Elias JABRE : Peut-être pouvez-vous revenir sur votre démarche de recherche et d’activisme politique, la façon dont vous concevez ce travail sans qu’il s’agisse de journalisme en convoquant la philosophie d’un côté, alors qu’il s’agit justement de philosophie de terrain (titre de votre précédent ouvrage) et la photographie d’un autre côté. Comment votre relation entretient-elle votre engagement commun, et comment fonctionne entre vous l’agencement couple en tant que « machine » militante et politique ?
Christiane VOLLAIRE, Philippe BAZIN : Notre démarche est en effet particulière, puisqu’elle associe philosophie de terrain et photographie documentaire critique, dans une recherche commune, qui s’est initiée il y a maintenant vingt ans, autour des processus de globalisation.
Un premier essai en a été, en 1999, un bref travail auprès de femmes militantes des Balkans. Puis, en 2008, un travail dans les centres d’hébergement et de rétention des migrants en Pologne. En 2011, en Égypte, autour des protestations s’inscrivant à la fois dans le printemps arabe et le mouvement des places. En 2012, au Chili, autour des revendications pour le logement et des politiques de la mémoire. En 2013, en Turquie, autour des protestations du Parc Gezi. En 2014, en Bulgarie, autour des immolations qui ont accompagné un immense mouvement de protestation. En 2016, dans les camps de migrants du Nord de la France. De 2017 à 2020, se déroulera le travail en Grèce présenté ici. Parallèlement se fera, en France, un double travail : sur le mouvement des Gilets jaunes et sur les quartiers populaires.
Sur tous ces terrains, nous partons ensemble et le travail se définit au départ en commun. Nous ne sommes militants d’aucun parti, mais sommes engagés, ensemble ou séparément, dans une recherche critique dont une part nous est commune, et qui suppose clairement un certain nombre de parti-pris politiques sans ambiguïté. La question des processus de globalisation est au cœur de notre travail. Et leurs abus manifestes fondent notre colère politique et un mépris à l’égard de nombreuses formes de gouvernementalité. Ce mépris va de pair avec notre estime et notre respect à l’égard des mouvements alternatifs dont nous souhaitons valoriser non seulement le travail, mais la pensée.
La manière dont les médias peopolisent les questions politiques et brandissent sans arrêt les portraits des dirigeants, même lorsqu’ils prétendent les tourner en dérision, nous paraît radicalement contre-productive. La manière dont le milieu journalistique dominant (au sens très large) guette leurs paroles, dont fonctionnent les comptes twitter comme un véritable abreuvoir, participe d’une mise en scène du pouvoir qui, même lorsqu’elle prétend le critiquer, ne fait que participer de son exhibition et de son omniprésence, alimente la notoriété. Et elle impose la référence constante, dans la représentation collective, à ce que le cinéaste Peter Watkins appelle « la monoforme ». Le fait même de nommer constamment les dirigeants participe de cette omniprésence et contribue à occulter cette simple évidence que, quelles que soient les décisions criminelles qu’ils mettent en œuvre, ils ne sont que les exécutants – et quasiment les hommes de main – de systèmes de gouvernementalité qui les rendent interchangeables.
Face à des directions politiques ostensiblement et de plus en plus systématiquement nuisibles, nous visons à mettre sur le devant de la scène des acteurs de l’histoire dont la notoriété est inversement proportionnelle à leur puissance critique, à leur capacité d’initiative ou à l’effet positif de leurs interventions. Surtout, nous visons à mettre en valeur la dimension collective de ces parcours, à travers même la puissance singulière de chacun.
Une telle démarche est axée sur la question de la représentation, par le texte comme par l’image. C’est ce qui fait que la question esthétique se pose aussi bien pour le travail textuel que pour l’iconographie. Représenter signifie pour nous sortir des mises en scène victimaires qui ne présentent les populations qu’en situation de soumission, de déchéance ou de misère, y compris sous le prétexte de leur venir en aide. Et nous avons à réfléchir philosophiquement ce que signifie un tel système de représentation.
C’est de la double conviction que la philosophie est un système de représentation et que la photographie est un système de pensée, que procède notre « agencement ». Et la manière même de travailler ensemble s’est modifiée au cours du temps et selon les terrains. En Pologne, je faisais les entretiens seule avec une interprète, et Philippe ne nous accompagnait pas. On arrivait ensemble le matin dans les centres d’hébergement pour migrants, on rencontrait les personnes ensemble, et ensuite Philippe partait faire des photographies des lieux pendant que les entretiens commençaient. On se retrouvait le soir à la voiture, et il avait passé une partie de la journée à lire en nous attendant, car le travail photographique va plus vite que celui des entretiens.
En Grèce au contraire, Philippe a décidé pour la première fois d’être présent aux entretiens et d’y faire des photos, avec l’autorisation des personnes, et ça a été le début d’un nouveau concept photographique : celui des Portraits d’entretiens, qui constituent l’une des spécificités de notre livre sur la Grèce.
Cette différence de temporalité est encore plus énorme au retour du terrain. Le travail de décryptage est déjà plus long que le travail sur les images ; mais ensuite, l’interprétation des entretiens, leur sélection, leur montage avec le texte et la recherche philosophique qui les accompagne, prennent un temps hors de proportion avec celui de la sélection des photographies, de leur montage et de leur agencement. Il faut six mois pour le photographe là où il faut en gros deux ans pour la philosophe. Et cela suppose beaucoup de patience pour l’un et beaucoup de pression pour l’autre. Le travail de terrain en Pologne s’est fait en 2008, le livre a été terminé en 2010 et publié en 2012.
Pour la Grèce, le travail de terrain s’est fait sur trois ans, représentant près de quatre mois de présence sur place : un mois entre la région de Thessalonique et Athènes en juillet août 2017, quinze jours sur l’île de Lesbos en février 2018, quinze jours sur l’île d’Ikaria en avril 2018, un mois et demi en Grèce continentale en juillet-août 2018 et une semaine à Athènes en janvier 2020. L’année 2019 a été consacrée au décryptage, à l’élaboration du plan, aux travaux de recherche et à l’écriture du texte. Dans le même temps, nous décidions ensemble, Philippe et moi, de l’organisation des chapitres de texte et des chapitres d’images, de leurs titres respectifs et de leur montage dans le livre. La brève incursion de janvier 2020 à Athènes était destinée à compléter des éléments qui me manquaient, et a permis que le texte puisse être ainsi finalisé fin mars pour être édité en août 2020, en vue de la présentation du livre à l’exposition organisée par le Centre de la Photographie de Genève à la fin du mois d’août.
Pendant tout ce temps de gestation, les photos présentes sous mes yeux contribuaient à la fois à réactiver ma mémoire des lieux et des gens, et à réorienter aussi le sens du texte. Par exemple, toute la focalisation de la dernière partie de notre livre sur l’histoire de la Grèce du XXème siècle, que nous n’avions pas prévue au départ, nous est venue d’abord des entretiens, dont les interlocuteurs ont mentionné des éléments d’histoire que nous ignorions, à l’été 2017. Mais à partir de là, ayant décidé d’aller visiter les lieux dont ils nous parlaient et de lire de façon plus systématique et approfondie sur l’histoire grecque, nous avons été guidés par les nécessités du travail photographique de Philippe, et non plus par la dynamique initiale des entretiens. C’est lui qui a dressé la « carte d’État-major » pour nous emmener sur l’île d’Ikaria, puis en Thessalie, en Épire, en Macédoine Occidentale, dans les Monts Grammos, sur les traces de la Résistance de 1940-44, de la guerre civile de 1946-49, des villages détruits, du camp d’internement et d’extermination fasciste de l’île de Makronissos. Dans tous ces espaces, ce sont les lieux qui nous ont parlé plus que les gens. Mais au retour, ce sont les photographies de Philippe qui ont reconfiguré l’imaginaire de ma mémoire pour me permettre d’élaborer le texte, en ayant sous les yeux non pas simplement une documentation photographique ou une archive, mais bien plutôt une interprétation des espaces par la création photographique, facilitant par sa réflexion mon propre travail réflexif : c’est le chapitre des Paysages à l’épreuve de l’histoire.
Pour tout cela, l’ « agencement couple » est évidemment une chance. Tous les échanges quotidiens contribuent à nourrir le travail. Mais aussi, l’aventure commune du terrain s’assume plus facilement dans sa dimension émotionnelle. Cette dimension émotionnelle n’est nullement l’objet du travail, mais elle contribue à le dynamiser, y compris – de façon très hégélienne – dans les conflits et les contradictions. Mais aussi dans la façon dont la dynamique de l’un peut se nourrir de celle de l’autre. De fait, même si le voyage est commun – et si les plaisirs autant que les inquiétudes partagés participent du travail – en revanche, les territoires disciplinaires, eux, sont bien délimités. Et la philosophe n’intervient pas plus dans les choix et les constructions d’images que le photographe dans l’élaboration des textes et le déroulement des entretiens. Et si l’on peut considérer que notre travail est bien un travail de recherche-création – au sens où la photographie est tout autant un travail de recherche que de création, et la philosophie tout autant un travail de création que de recherche –, cependant, chacun demeure le professionnel de son domaine et cette forme de « séparation des pouvoirs » nous paraît, à l’un comme à l’autre, indispensable à la rigueur du travail commun tel que nous le concevons actuellement. Cela n’empêche évidemment pas les discussions, puisque chacun est le premier relecteur de l’autre. Mais la décision finale revient à chacun dans son domaine.
E.J : Avant d’aborder le fond de votre livre « Un archipel de solidarité », peut-être peux-tu rappeler l’histoire de la Grèce depuis la deuxième guerre mondiale, cette histoire occultée, où alors que l’Europe sortait du fascisme, l’Angleterre à travers Churchill aura paradoxalement soutenu les fascistes grecs contre les communistes victorieux des nazis, et ce qu’il en est aujourd’hui dans ce retour du refoulé, qu’il s’agisse de groupes d’extrême-droite comme « L’aube dorée » ou au contraire des collectifs de gauche que tu évoques dans votre livre.
C.V : Oui, l’histoire de la Grèce est à la fois très spécifique et très emblématique. Spécifique de la situation géographique de ce pays au cœur de l’Europe, et emblématique des choix géopolitiques européens que cette situation permet de cristalliser. La création même de « la Grèce » comme État-nation, au début du XIXème siècle, est particulièrement révélatrice. Car la Grèce est bien une création des nations européennes occidentales contre l’Empire ottoman. Tout en étant l’objet d’une rivalité entre ces nations et la Russie. En pleine période romantique, lorsque l’écrivain anglais Byron s’engage sur le terrain grec, lorsque le poète français Hugo écrit « L’enfant grec » ou que Delacroix peint « Les massacres de Chios » ou « La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi », il s’agit bien d’œuvres de propagande, destinées à faire valoir l’émergence d’une nation grecque – tout à la fois et contradictoirement chrétienne et issue de l’esprit d’émancipation des Lumières – contre la « barbarie » et l’ « obscurantisme » ottoman. Et c’est pour des raisons bel et bien économiques que la révolution grecque de 1821 est soutenue par le Royaume Uni, la France et la Russie.
Cette histoire n’a rien à voir avec celle de la Grèce antique, sur laquelle s’appuie le mythe romantique d’une Grèce « berceau de l’Occident ». Et d’ailleurs les représentations de « la Grèce » antique sont elles-mêmes très loin de la réalité grecque de l’Antiquité dans sa très grande pluralité. La Grèce, comme notre livre tente de le souligner, est d’abord géologiquement un archipel, dont l’émergence des cités grecques n’est qu’un espace et un moment particulier, au sein desquels Athènes elle-même fait bien plutôt figure d’exception que de règle. « La Grèce » antique est un espace de colonisation, qui s’origine dans la période archaïque, trouve sa forme diasporique dans la période héllénistique et finira par se fondre dans l’Empire romain avant de ré-émerger, pendant toute la durée du Moyen-Âge, dans les spécificités de l’Empire byzantin… qui dure pendant un millénaire, du Vème au XVème siècle. Dans tout ça, l’ « âge d’or » du Vème siècle av. JC – celui de la Grèce dite classique, qui voit naître ou mourir tous les auteurs de référence de Platon à Hippocrate en passant par Hérodote et Sophocle, ne représente, sur le plan de la durée, quasiment rien. Et il suffit de lire Thucydide, qui en est contemporain, pour comprendre à quel point cette période est elle-même sujette à conflits et fragilisations.
Ça paraît très loin de la question du XXème siècle. Et pourtant, l’ignorance où nous sommes souvent de ce qu’a été réellement l’Empire byzantin et de la manière dont il a formé une grande partie de l’esprit grec – bien plus et plus récemment que le récit de l’Iliade – empêche souvent de comprendre ce qu’a été la relation des Grecs à l’Empire ottoman qui l’a à la fois vaincu et absorbé au XVème siècle, contribuant dans le même temps à véhiculer sa culture. L’intervention des nations occidentales au XIXème siècle s’est faite sur ce malentendu. On peut dire que l’invasion des ottomans a été partiellement respectueuse de la culture byzantine, alors que l’aide des nations occidentales l’a profondément ignorée.
Et au final, c’est sur ce même mépris de la réalité grecque que reposera l’intervention des Alliés. La Résistance grecque des années 1940-1944, largement menée par les communistes, fait en même temps revivre un esprit de la résistance à l’Empire ottoman dans la guerre d’Indépendance du XIXème siècle. Le chef de la Résistance Aris Velouchiotis, en particulier, va reconvertir la figure du bandit-guerillero caché dans les montagnes en figure du résistant progressiste, faisant du maquis un espace d’égalisation sociale et politique. Dans bien des villages se crée un système de « laocratie », « laos » signifiant le peuple au sens véritablement populaire du terme, par différenciation du « démos » qui signifie une population au sens large. Un accès donc à la représentation directe, à un système de tribunaux de village plus transparent et plus rapide pour régler les litiges, à des décisions prises collectivement. Bref à une participation plus en prise sur la réalité de la vie sociale : un mode de gouvernementalité plus horizontal. C’est tout cela qui est insupportable aux Alliés, parce qu’évocateur de l’idéologie communiste originelle. Précisément celle que le stalinisme a trahie. Tout cela contribue grandement à la popularité des andartès (les résistants luttant non seulement contre l’invasion allemande, mais contre l’idéologie fasciste qu’elle véhicule).
De manière perverse, les Alliés vont à la fois se servir des victoires des andartès contre les nazis, et susciter contre ces résistants des groupes inféodés à l’Angleterre et financés par elle pour entrer en rivalité contre cette résistance de gauche.
En février 1945, les Accords de Yalta, signant la défaite nazie, actent un partage de l’Europe entre les vainqueurs de l’Est et ceux de l’Ouest, aux termes duquel la Grèce est incluse dans le camp occidental. La résistance progressiste sera donc lâchée par l’URSS stalinienne. Et les Anglais, sous l’impulsion de Churchill, vont utiliser les milices collaboratrices des nazis qui viennent de perdre la guerre, pour combattre et persécuter les résistants communistes qui viennent de la gagner. On est là très clairement dans les origines de la guerre froide. Et, à partir de 1945, l’Angleterre économiquement affaiblie va laisser la place aux Etats-Unis de la « doctrine Truman » interventionniste. Le plan Marshall, supposé aider à la reconstruction, va trouver en Grèce son application militaire. C’est en Grèce que seront faits les premiers essais de bombardement au napalm, contre les résistants, qui seront ensuite utilisés par la France en Algérie, puis plus massivement par les Etats-Unis au Vietnam. La guerre civile grecque, qui commence en 1945 par l’assassinat du vainqueur communiste Aris Velouchiotis, se terminera en 1949 par l’écrasement de l’armée démocratique sous les bombardements américains. La conséquence en sera une persécution politique massive contre les opposants au fascisme grec, dont le camp de Makronissos, mentionné précédemment, est l’un des lieux emblématiques.
Cette guerre civile est au cœur d’enjeux de mémoire et de réalité sociale tragiques et paradoxaux. Les fascistes au pouvoir, et l’ultraviolence qu’ils véhiculent, assument une culture de la violence d’autant plus paradoxale qu’ils ont été vaincus à l’origine, et n’ont dû leur retour sur la scène politique qu’à une double intervention étrangère. Les forces de gauche sont au contraire conscientes d’une victoire réelle dont elles ont été spoliées.
Le retour du refoulé fasciste trouve son plein accomplissement dans les exactions et crimes du mouvement Aube dorée, dont un procès retentissant s’est déroulé dans les six dernières années. Le retour du refoulé progressiste se glisse dans la force des mouvements solidaires actuels contre la violence économique européenne : on y voit les traces de ces perspectives de « laocratie » précédemment mentionnées. Mais quelque part, cette violence économique européenne emmenée par l’Allemagne suscite aussi la mémoire de la résistance au nazisme.
E.J : L’archipel est une notion géographique que tu empruntes à Foucault qui lui-même la prend de Soljenitsyne dans son célèbre ouvrage, L’archipel du Goulag, un archipel punitif qui permet de penser deux pays entremêlés sur le même territoire, dont l’un contamine l’autre. Vous retournez la notion pour montrer l’émergence d’un archipel des solidarités locales, nationales et internationales qui affrontent les gouvernementalités globales. De même, tu reprends la notion de solidarité dans un emploi politique en la déplaçant de son usage nationaliste qui dissimule les rapports de classe. Comment en es-tu venue à croiser ces deux notions pour les déplacer l’une et l’autre, et donner la démarche de votre philosophie de terrain ?
C.V : Foucault dit de la notion d’archipel que c’est à ses yeux la seule notion « véritablement géographique ». C’est dans un entretien qu’il donne à la revue de géopolitique Hérodote pour son premier numéro, paru au premier trimestre de 1976. Les responsables de la revue se réfèrent à la définition que Foucault, dans L’Archéologie du savoir, a donnée des formations discursives comme « système de dispersion réglé ». « Système de dispersion » semble constituer un oxymore, puisque là où il y a système, c’est-à-dire unité, il ne peut y avoir dispersion. Mais c’est justement ici la dispersion qui fait système. Et les fondateurs de la revue lui disent qu’un tel concept leur a permis de mieux cerner le discours géographique. C’est donc cet ordonnancement des éléments dissociés dans une logique commune qui fait géographie, c’est-à-dire qui fait qu’on peut précisément « écrire la terre », ou réduire la matière aux données rationnelles. L’archipel, c’est donc un ensemble d’îles dont l’émergence est rattachée à un socle commun invisible, puisqu’il est immergé. Archè signifiant en grec l’origine ou le fondement ancien qui échappe au regard. Et c’est cette dimension de l’invisible qui est prise en charge par le discours géographique, mettant en évidence le commun là où il ne semble y avoir que de la séparation. Soljenitsyne avait ainsi montré, en 1973, à travers cette métaphore de L’Archipel du goulag, la cohésion d’un système punitif à l’œuvre dans toute l’URSS, en-deçà de la dispersion apparente des lieux de travail forcé et d’enfermement, de leurs localisations sans commune mesure et de leur éloignement. Il en montrait ainsi les effets pervers de dislocation sur l’ensemble de la vie sociale. Nous avons choisi de nous saisir de cet usage pervers de la dislocation pour le retourner contre la violence dominatrice elle-même. Les politiques néolibérales ont dissous et perverti les possibilités de se défendre contre elles à l’intérieur des espaces nationaux. Leur hégémonie transnationale semble avoir dispersé les possibilités de lutte. Nous voulons au contraire montrer ici que cette dispersion n’est qu’apparente : au-delà des luttes locales se fait jour la conscience de l’affrontement à une hostilité économique globale. Et c’est dans cette mesure même qu’on peut parler d’un « archipel des solidarités ». La Grèce est pour cela un pays doublement emblématique : d’une part elle est constituée elle-même, géographiquement, comme un archipel, avec un espace insulaire très important ; d’autre part les luttes qui s’y mènent sont représentatives des luttes plus générales et des alternatives qui se font jour au niveau mondial. Enfin, l’histoire grecque du XIXème siècle est liée à la construction de l’espace européen nationaliste. Tout comme l’histoire grecque du XXème siècle est liée aux deux Guerres mondiales, la première ayant trouvé son origine dans l’espace balkanique et la Deuxième s’étant soldée par une division de l’Europe dont le statut de la Grèce a été un enjeu stratégique majeur.
La notion de solidarité est au cœur de ces enjeux. Je ne vais pas répéter ce que dit le livre, mais il montre le passage du mot « solidarité » de son sens juridique originel, lié en particulier à Rome à la question des répartitions de biens et des transmissions de patrimoine, à son sens politique émergeant à la fin du XVIIIème siècle, à la suite de la révolution française, pour signifier un rapport à la nation qui se dissocie de la personne du roi pour fonder un corps politique. Au XIXème siècle, le concept de solidarité organique vaudra autant en médecine avec Claude Bernard qu’en sociologie avec Durkheim. Claude Bernard montre comment aucun organe ne peut fonctionner indépendamment de l’ensemble du corps, et comment la vie elle-même est donc dépendante de cette solidarité organique. Pour Durkheim, la solidarité organique est à l’origine de la division du travail social, au sens où le travail est ce qui associe la dimension économique de la production à sa dimension politique, Toute cohésion du corps politique ne peut donc passer que par le travail. Et c’est la raison pour laquelle ce qu’il appelle « anomie économique », c’est-à-dire la dérégulation des rapports de production, est à ses yeux un véritable attentat à l’intégrité du corps social.
E.J : Ton écriture, Christiane, consiste à intégrer des citations de philosophes pour éclairer des témoignages comme pour créer un dialogue entre un contexte social et la philosophie dans laquelle tu puises pour souligner l’élément vital d’une situation de terrain. L’élan vital semble toujours mis à mal par un pouvoir corrompu qui menace à chaque page de faire tomber en dépression les membres du pays. Par exemple (p 20) une citation de Spinoza sur la joie est suivi du témoignage d’un médecin de Thessalonique engagé dans le développement d’un dispensaire solidaire. Qu’est-ce qu’apporte pour toi le contenu philosophique au témoignage, étant donné que ces personnes sont déjà engagées ? Est-ce une façon de monter votre récit à partir d’une lecture philosophique « vitaliste » que vous avez préparée au préalable par une analyse, ou votre récit s’est-il monté au fur à mesure de votre expérience sur le terrain avec les doutes éventuels qui vous auraient assaillis au fil de vos déplacements ?
C.V : J’aime bien la manière dont tu fais de la philosophie ce qui souligne l’élément vital d’une situation de terrain. C’est en quelque sorte le travail philosophique qui vitalise le terrain lui-même. C’est cela en effet, l’expérience de la philosophie de terrain : une nouvelle énergie donnée aussi bien au terrain qu’à la philosophie. Le concept n’est pas une pure abstraction spéculative, mais au contraire ce qui fait le lien entre le réel et la pensée, ou, pour reprendre l’expression de Deleuze et Guattari répondant à la question Qu’est-ce que la philosophie ?, une « création de concepts », en donnant au terme de création toute sa puissance. Et cela prend une forme : c’est la manière dont le texte tisse ensemble les éléments d’un triple matériau discursif : celui de la parole des entretiens, celui de mon propre discours tiré de cette parole, et celui des citations d’auteurs qui viennent entrer en résonance avec les deux niveaux de langage précédents, pour leur donner un autre éclairage ou pour en orienter les conclusions. J’aime bien aussi ta lecture, soulignant ce « pouvoir corrompu qui menace à chaque page de faire tomber en dépression les membres du pays ». On y lit cette puissance dévitalisante des systèmes de domination, en même temps que la puissance réénergisante des solidarités. Au dispensaire de santé solidaire de Thessalonique, auquel tu te réfères, il y a eu toute une séquence d’empuissantement : des médecins ont aidé des travailleurs sans papiers à mener une grève de la faim, ils les ont suivis médicalement en respectant intégralement leur volonté de non-alimentation, mais aussi en les aidant à communiquer pour donner la visibilité nécessaire à leur mouvement. Et la victoire remportée, dans ce combat difficile, par les sans-papiers (qui ont obtenu leur statut) a donné une force incroyable aux acteurs de cette solidarité, les engageant à créer de toute pièce et à ouvrir ce dispensaire de santé solidaire, cette fois pour la population grecque elle-même. Le courage des demandeurs d’asile a fait modèle pour les sédentaires grecs eux-mêmes. Il a été une source à la fois d’inspiration et d’énergie, en créant en même temps l’expérience d’une lutte victorieuse commune. Tout le contraire d’une situation d’assistance.
Pour répondre à ta question, si c’est notre réflexion et notre engagement préalable qui nous ont menés sur ce terrain et donné le désir d’y travailler, c’est en revanche le terrain lui-même qui a nourri notre pensée, en termes d’images comme en termes textuels. Tu as donc raison de qualifier notre lecture de vitaliste, mais cette vitalisation est à double sens : elle insuffle notre orientation du terrain, et elle s’en nourrit. C’est la raison pour laquelle je n’appelle pas « témoignage » la parole des personnes rencontrées : elles ne sont pas les témoins des situations dont nous traitons, mais elles en sont les acteurs, comme acteurs d’une grande histoire collective qui prend à chaque fois des dimensions singulières. Quant à nos doutes en cours de travail, ils ne portent pas sur la nécessité de ces mouvements collectifs, mais plutôt sur la justesse de nos angles d’attaque pour les analyser et les mettre en valeur. Ces mouvements ne sont pas de court terme : ils sont ancrés dans une histoire de la Grèce où ils puisent leur propre inspiration. Et c’est à nous d’être à la fois proches et distants de ces mouvements : suffisamment proches pour tenter d’affiner notre regard à leur contact, et suffisamment distanciés pour leur apporter des éléments de recul et d’analyse.
E.J : Pour continuer sur ta description d’un corps social trahi et de la grande santé nietzschéenne, tu reportes ton analyse anti-capitaliste dans les propos d’une biologiste qui elle-même oppose la banque à la vie pour le dire vite. Si la Grèce est la faillite d’un système mondial, peut-on pour autant soutenir un tel discours sans risque ? N’est-ce pas ce même discours contestataire très affirmé qui aura provoqué, après avoir tant enflé, l’état de désidération que tu décris où de nombreux supporters de Syriza seront tombés en dépression après leur soutien à un gouvernement qui les aura trahis et qui croyait pouvoir modifier la politique locale, alors que la Grèce est également tissée avec des accords internationaux ? Plus précisément, si l’autogestion semble l’horizon que portent ces archipels, comment inscrire cette autre politique sans composer avec l’écriture existante d’une gouvernementalité globale, en la modifiant au fur à mesure, au risque sinon de sortir du marché avec la menace d’un effondrement peut-être plus grave, ou celle d’y retourner aux conditions de l’adversaire en rechutant dans l’impuissance et le désespoir, comme c’est arrivé ?
C.V : Là, je ne peux pas partager ton discours, qui reprend précisément celui des gouvernementalités mondiales : le « risque » de sortir du système financier (la zone euro en particulier) européen et global n’a cessé d’être le motif du chantage exercé par la troïka pour amener la population grecque à répondre positivement au referendum sur l’acceptation des mesures infligées par le système des banques européennes et mondiale. Pour les Grecs – de façon plus violente encore qu’ici – la dégradation du monde du travail et de la sécurité sociale est plus qu’un risque : c’est une réalité vécue au quotidien comme particulièrement destructrice. Et elle est précisément liée au système, construit de toutes pièces, de la « dette », puis à l’intégration à la zone euro qui n’est que l’une des pièces stratégiques de la manière dont s’est construite l’histoire grecque comme histoire subalterne au sein de l’Europe.
Donc, lorsqu’on dit « la Grèce », de quoi parle-t-on ? Des dirigeants grecs, des armateurs, des banquiers ? Des segments de la population grecque livrés à la misère ? Des classes moyennes en voie de précarisation et de paupérisation ? De ceux qui se situent dans la filiation de l’histoire fasciste de la Grèce ? De ceux qui revendiquent une contre-histoire puisant sa source dans les réalités de la résistance ? « Composer avec les gouvernementalités globales », c’est précisément ce qui est impossible parce qu’elles ne composent pas. C’est ce que montre le livre de Grégoire Chamayou sorti en 2018 La société ingouvernable. C’est ce que montre aussi le dernier ouvrage de Dardot et Laval (écrit en collaboration avec Pierre Sauvêtre et Haud Gueguen) Le Choix de la guerre civile. Il y a un moment où il devient manifeste que les pouvoirs politiques nationaux traitent leur propre population en ennemi. On l’a vu en France avec le mouvement des Gilets jaunes, où la police utilise des armes semi-létales pour mutiler et terroriser. Et la première réalisation la plus patente du néolibéralisme au début des années 1970 a été le coup d’État au Chili, et le régime de terreur qu’il a imposé pour des décennies, avec ce que Dardot et Laval appellent une « consitutionnalisation du marché » : la violence d’État (en termes juridiques comme en termes policiers) mise au service du marché.
E.J : Quand vous évoquez la recherche d’un NOUS qui ne soit pas le peuple au sens courant, et qui se déplace, pouvez-vous développer cette relecture du commun ? Notamment quand tu parles des Allemands qui se désolidarisent de leur politique nationale pour nouer avec les grecs qui la subissent ?
C.V : Ça renvoie à ce que je viens de dire en posant la question « lorsqu’on dit la Grèce, de quoi parle-t-on ? ». On pourrait dire la même chose pour l’Allemagne, et pour tous les pays du monde, puisqu’il n’y en a guère dont les dirigeants ne trahissent pas à un moment ou à un autre, et de façon structurelle, l’intérêt collectif ou ce que Rousseau appelait « la volonté générale ». Moi-même par exemple, en 2008, je n’ai pu obtenir des entretiens avec des réfugiés tchétchènes en Pologne qu’en me présentant pour ce que je suis : française certes par les papiers, mais opposante dans mon propre pays. Sinon, comment des personnes qui avaient été violentées par la police française à l’aéroport de Roissy auraient-elles accepté de me parler ? Et en Allemagne, en effet, un certain nombre de médecins opposés à la politique de leur propre pays envers la Grèce ont soutenu l’ouverture des dispensaires de santé solidaire. La définition par la nationalité apparaît ainsi de plus en plus contestable, même si celle-ci oriente bien sûr de façon beaucoup plus profonde notre culture, nos manières de penser ou ce que Bourdieu appelle nos habitus.
Qui est NOUS ? est le titre de l’exposition commune que nous avons faite à Gentilly en octobre 2019, et qui portait précisément sur les reconfigurations du « Nous ». L’un des « éléments de langage « les plus inacceptables dans les discours médiatiques des dirigeants est justement le fait qu’ils s’autorisent à parler en tant que représentants d’un peuple dont ils combattent incessamment les intérêts les plus élémentaires. Et leur mandat électif repose sur un autre mensonge, puisqu’il leur permet de fonder une politique du marché de plus en plus fascisante sur l’épouvantail brandi de « l’extrême droite », au nom donc d’une prétendue lutte contre le fascisme.
On voit ici, à tous les niveaux, à quel point l’idée de nation est à la fois un facteur de rassemblement (qu’elle a pu être légitimement au moment de la révolution française pour lutter contre l’oppression monarchique) et un leurre. À quel point elle est à l’origine de ce que l’historien Georges Mosse appelle une « brutalisation du politique » qui trouve sa manifestation la plus emblématique dans la boucherie inutile de guerre de 14. Kantorowicz s’interrogera sur ce standard du « donner sa vie pour la patrie ».
La question est donc : en quoi peut-on reconnaître, en d’autres, des valeurs, des aspirations et des intérêts communs qu’on pourrait être prêts à défendre ? Et de ce point de vue, très clairement, la question des migrants est emblématique. Quand Balibar écrit « Ce que nous devons aux sans-papiers », c’est de cela qu’il traite : le commun est transnational, et nous avons beaucoup plus à partager, du point de vue de l’énergie politique, avec des sans-papiers qu’avec nos propres dirigeants, qui nous sont devenus non seulement étrangers, mais très clairement ennemis et traîtres à ce qui pourrait être une cause commune. C’est bien ce communautarisme de l’entre-soi néolibéral qui est à combattre.
E.J : Vous décrivez une multitude d’expériences collectives qui transforment les rapports sociaux et la politique en transformant la subjectivité, citant d’ailleurs Guattari et son écosophie (un dispensaire solidaire à Athènes, une association de quartier, etc.). Peut-être peux tu insister sur l’une d’entre elles comme ce collectif de salariés qui prend les rênes d’une entreprise de colle au moment où les dirigeants quittent le navire (Viome p64), en pleine crise. Comment êtes-vous rentrés en contact avec ces salariés autogérés ? Quelle est l’histoire de cette entreprise ? Est-elle devenue une référence et y a-t-il d’autres sociétés qui la prennent comme modèle ? Peut-on parler d’un effet d’entraînement, ou cela reste-t-il marginal ?
C.V : L’entreprise de colles et solvants Filkeram & Johnson est déclarée en faillite en 2011, ses patrons l’abandonnent sans payer leurs ouvriers. Ceux-ci, après un an d’occupation de l’usine, décident de la reprendre en 2012. Ils changent la production : savons et produits d’hygiène et d’entretien et le nom qui, en 2013, devient Viome. Reprise ainsi par des ouvriers militants déterminés, l’entreprise vit depuis en autogestion, dans des conditions particulièrement difficiles, en butte à l’hostilité à la fois de ses anciens propriétaires et des spéculateurs qui veulent se réapproprier le terrain. Mais ils réussissent à créer un puissant réseau de solidarités internationales, à la fois avec d’autres secteurs en autogestion (en Amérique latine en particulier), et avec des coopératives qui les aident à vendre et diffuser leurs produits. Un équilibre très précaire, supposant des salaires minimaux. Cela leur permet non pas seulement une source de revenus (quelque modique qu’elle soit), mais surtout une véritable dignité politique et sociale. Leur détermination est unanimement saluée, dans le temps même où elle est violemment combattue et mise en péril : ils ont échappé de peu à la vente aux enchères qui menaçait leur terrain et leur outil de production.
Leur combat en Grèce est à vrai dire héroïque, en particulier dans les conditions actuelles de néolibéralisme sauvage, dont la violence de la vente aux enchères comme pratique courante est un exemple. L’électricité leur a été aussi coupée. Et s’ils ont été peu défendus par le gouvernement de gauche de Syriza, ils sont maintenant violemment combattus par le gouvernement de droite de la Néa Démokratia. Mais ils parviennent à tenir, et constituent en effet un modèle aussi bien grec qu’international.
Nous les avons rencontrés en juillet 2017, lors de leur AG qui s’est terminée par une fête en vue de récolter de l’argent pour le départ de deux d’entre eux en Argentine, à une Rencontre internationale des coopératives d’autogestion ouvrière. Nous avons alors pris rendez-vous avec eux pour venir les rencontrer dans leur usine de la périphérie de Thessalonique le lundi suivant. Nous y avons passé la journée en déjeunant avec eux. Quelques uns d’entre eux nous ont emmenés à tour de rôle dans leurs espaces de travail, permettant de riches discussions que je préfère vous laisser découvrir dans le livre.
Pour toutes ces initiatives solidaires, la difficulté est de tenir sur le long terme. C’est encore plus difficile quand l’initiative est la source même de leurs revenus, comme pour Viome. Ce qui les place dans une situation très différente de celle des volontaires d’associations solidaires, qui n’attendent aucune source de revenu de leurs actions. Mais la ténacité des acteurs de Viome est à l’exemple de leur rigueur morale et de leur volonté d’égalité en termes d’équité autogestionnaire entre les salariés en cogestion. En huit ans d’existence, le groupe s’est renouvelé. Mais plusieurs sont là depuis le début et l’esprit de revendication solidaire qui les anime demeure pleinement.
E.J : Comme tu décris un archipel des solidarités qui est aussi international, quels sont les types de liens qui se tissent entre pays voire continents, notamment comment l’Argentine qui a déjà une longue expérience de l’autogestion par temps de crise aura-t-elle pu aider les Grecs, et quelle est la progression de ces alternatives ? Celle-ci est-elle assez significative pour créer un autre espace mondial ?
C.V : Là, on peut répondre brièvement, justement parce que ce qui tisse les liens, ce sont les motifs mêmes des combats. Quand nous allons par exemple à Skouriès, territoire sur lequel une multinationale canadienne installe une mine d’or avec l’autorisation plus ou moins explicite et la complicité plus ou moins active des pouvoirs politiques successifs plus ou moins corrompus, nous y trouvons un campement sauvage organisé depuis longtemps pour s’opposer à l’ouverture de la mine. Et plusieurs d’entre eux ont déjà affronté, pour ce faire, la violence des compagnies policières que nous voyons déployées sur le chemin à l’arrivée. Ces opposants sont de toutes nationalités : ce sont des militants écologistes pour lesquels la pollution des nappes phréatiques par l’usage du mercure (indispensable à l’extraction aurifère) est une problématique internationale : c’est la même chose, indépendamment même de l’exploitation des ouvriers mineurs, partout où se produit l’extraction de l’or. De même, dans les espaces dédiés à l’accueil des migrants, non seulement les migrants mais les volontaires sont issus de toutes les nationalités, vivant sur leurs propres territoires d’origine la destruction économique de leur propre peuple, l’accueil indigne des étrangers et les violences qui leur sont infligées. Et, puisque tu prends l’exemple de l’Argentine, il est clair que la violence économique qu’elle a subie, nécessairement associée à la violence politique, a tout à la fois fait exploser le concept même de classe moyenne (puisque la précarisation en a fait basculer une large part dans la pauvreté et la misère) et suscité la créativité des alternatives autogestionnaires. Comme au Chili, l’ultraviolence politique des années 70 contre les opposants, permise par la militarisation du pouvoir, s’est associée au déchaînement de l’ultralibéralisme économique. Et l’effet en a été une paupérisation sans précédent de toute une partie de la population argentine au tournant des années 90. Dès lors que la violence d’État se conjugue à son échec économique en tant qu’État justement, il est clair que l’alternative autogestionnaire devient une nécessité vitale. Celle-ci ne permet pas seulement de dénoncer le surplomb étatique, mais de mettre en évidence, à partir de ce modèle autoritaire ridiculisé et défait, l’aporie du modèle entrepreneurial pour penser les relations socio-politiques, tout autant que les rapports de production économique. Et une telle mise en évidence vaut bien sûr au niveau mondial pour penser la solidarité entre les différents modèles autogestionnaires. D’où les rencontres internationales de coopératives, qui permettent d’échanger des expériences et des expertises. Mais aussi de se conforter mutuellement et de se soutenir dans les luttes.
E.J : Tu contestes le « prendre soin » alors même qu’il fait partie des dimensions que les militants que tu décris ont intégrées. En quoi la politique du care serait-elle une anti-politique nuisible et non pas une ouverture parmi d’autres ? Faut-il s’opposer à la politique du care au nom de la véritable praxis politique ? Ne faut-il pas redéfinir une lutte plus multiple et hétérogène ?
En 2007, j’ai publié un petit ouvrage intitulé Humanitaire, le cœur de la guerre. Il faisait suite à ma propre expérience au sein de l’ONG Médecins Sans Frontières, dont je ne faisais pas état car mon intention était d’écrire un bouquin de philo politique, et non pas de raconter mon expérience. Donc, paradoxalement, j’y faisais abstraction du terrain que j’avais pourtant réellement fait comme infirmière (en Angola et au Sierra Leone), et qui aurait pu légitimer empiriquement mon propos. Mais l’esprit de ce livre était de montrer à quel point l’intention de bienveillance est ambiguë, et à quel point elle est vectrice d’effets antagonistes à ceux qu’elle prétend promouvoir. En 2009, je coordonnais le numéro 46 de la revue Pratiques, intitulé « L’humanitaire est-il porteur de solidarité ? »
En 2017, j’ai publié, dans un numéro de la revue Appareils consacré à la question du care, un texte intitulé « Prendre soin : contre qui ? ».
De manière générale, je n’ai pas cessé de noter les effets pervers de l’intention de prendre soin. Et de nouveau, en allant sur le terrain grec, j’ai rencontré exactement les mêmes problématiques, soulevées par tous les acteurs de solidarité que j’ai pu rencontrer. Du moins ceux qui avaient à cœur de réfléchir leur pratique.
La question n’est évidemment pas de prétendre que les politiques du care soient en soi nuisibles. Mais plutôt de montrer à quel point le concept, dans sa dimension précisément consensuelle, est faible et ne peut en aucun cas permettre de désigner et de combattre les violences auxquelles nous sommes affrontés. Toutes les politiques coloniales se sont accompagnées d’une justification par le care, dont le personnage du Docteur Schweitzer est emblématique. Et de manière générale, au sein même des associations qui se définissent par leur volonté de solidarité, l’écueil à éviter est de réduire celle-ci à une forme d’assistance sans réciprocité.
Il ne s’agit évidemment pas de nier la nécessité de l’attention à l’autre, mais bien plutôt que cette nécessité éthique puisse constituer une politique. Et, plus encore, qu’elle puisse représenter une valeur hégémonique. Car bien évidemment cette éthique du care va d’abord servir de justification ou de cache-sexe à la violence politique. Le militaro humanitaire en a été l’un des effets les plus ostensiblement pervers.
J’ai noté au sein des politiques d’enseignement un problème du même ordre : au nom de la « bienveillance » envers les élèves, devenue paradigme du comportement enseignant, une absence totale d’exigence conduisant à ne plus rien attendre de celui qu’on est censé diriger dans sa progression, et dont on est supposé susciter, soutenir et orienter les efforts.
Le problème est donc précisément que le care n’est nullement « une ouverture parmi d’autres », mais bien plutôt un principe, devenu hégémonique, de surplomb. Les politiques menées dans les quartiers populaires en attestent, oscillant entre l’assistance et la violence policière, qui ne sont jamais que les deux faces d’une même position de domination.
E.J : Philippe, peux-tu en dire un peu plus sur votre politique des images ? Le parti pris photographique est-il inspiré du travail de Martha Rosler que tu cites (p48) ? Quelle est sa spécificité dans l’écart qu’elle cherche à produire avec la représentation ? Est-ce que votre démarche lui est entièrement fidèle ou est-ce qu’elle s’en démarque également ?
P. B : Pour répondre à cette question, il faut resituer l’œuvre de Martha Rosler dans son contexte. Tout d’abord elle suit à San Diego son professeur David Antin qui vient d’être nommé à l’Université de Californie à San Diego (UCSD) dans les années 1960. David Antin est un poète, écrivain, performeur des mots, qui va rapidement devenir l’âme d’un groupe d’étudiants, groupe informel qui se retrouve toutes les semaines pour discuter d’art et de politique. L’influence de Antin est déterminante, non seulement sur Rosler, mais aussi sur Alan Sekula, Fred Lonidier, Phel Steinmetz et quelques autres, ce qu’on identifie maintenant comme le Groupe de San Diego.
Le deuxième élément du contexte tient à la réflexion que ces jeunes artistes mènent sur la photographie et la manière dont les institutions dominantes dans le domaine (le MoMA de New York) promeuvent une politique formaliste calquée sur les analyses de Clément Greenberg. Il fallait alors évaluer la photographie passée et présente seulement à l’aune de ses qualités formelles, « photographiques », oubliant leurs contextes d’apparition. Cette attitude est très sensible concernant les photographies de la FSA dans les années 1930 dont on minore les conditions sociales et politiques d’apparition au profit de leurs qualités esthétiques non dénuées de nostalgie. Au moment où l’Amérique est en guerre contre des paysans au Vietnam, où la lutte pour les droits civiques se radicalise, où les questions de genre arrivent sur le devant de la scène, où le penseur Herbert Marcuse est devenu la référence d’une génération, Martha Rosler et les autres s’étonnent de la quasi absence de ces questions dans l’art américain dominant de leur époque, que ce soit dans l’art expressionniste abstrait, l’art minimal ou l’art conceptuel.
Pour le groupe de San Diego, il s’agit de réintroduire les questions sociales dans l’art certes, mais surtout de dépasser ces questions en les situant dans leurs contextes politiques et idéologiques contemporains. Ainsi produisent-ils des œuvres de jeunesse tout à fait remarquables, comme Aerospace Folktales (Alan Sekula, 1973), Oil, Profit, control (Phel Steinmetz, 1973), The Health and Safety Games (Fred Lonidier, 1976) alors que Martha Rosler accède à la renommée avec Bringing the War Home (1967-1972). Précisément, dans cette œuvre se croisent les questions de la guerre, du féminisme et des mass-média dont la critique est acerbe.
Rosler entre en écriture au début des années 1980 avec un texte magistral sur la question documentaire, Pensées au cœur, autour et au-delà de la photographie documentaire (1981), texte qui en appelle à une radicalisation de la position documentaire qui doit cesser, pour elle, de rassurer les classes moyennes sur leur situation tout en s’apitoyant sur les misères du monde, pour au contraire prendre parti et dénoncer l’hégémonie de la finance sur la ville, le racisme, le sexisme, l’oppression de classe et la guerre. Dans un autre texte de 1983, Figure de l’artiste, figure de la femme, Rosler en appelle à un art féministe, non au sens où les femmes prendrait la place des hommes dans un même objectif de domination, mais pour un art plus participatif fait d’échanges, d’égalitarisme, de critique de la domination et du productivisme, et même d’une anonymisation de la signature par le collectif. Cela passe pour elle par le partage des compétences y compris avec les non artistes, ce qu’elle met en œuvre dans une célèbre exposition à la Dia Art Foundation au cours de l’année 1989 quand elle crée dans ce centre d’art huppé un home pour sans-abris durant plus de six mois. If you Lived Here… fait se rencontrer des dizaines d’artistes, producteurs de films, écoliers, activistes, squatters et SDF autour d’une utopie de la vie en ville.
Ainsi, si l’on considère tous ces éléments que j’ai rapidement résumés, ceux-ci font partie des principes actifs de notre démarche. Il ne s’agit pas de se dissoudre dans une entité, Christiane a bien dit que chacun de nous deux reste maître de ses compétences spécifiques, mais nous sommes convaincus que tous les terrains que nous abordons sont à la recherche d’une sorte de triangulation où l’expertise de chacun est au service des autres. Nous ne sommes pas spécialistes des migrations alors que tous les migrants que nous avons rencontrés le sont, nous ne sommes pas non plus spécialistes des questions urbaines alors que les gens relégués par le gentrification des grandes villes dans le cadre de la globalisation le sont, etc. D’où cette proposition photographique concernant les gens, les Portraits d’entretiens, qui ne cherche pas une représentation des états d’âme des personnes interviewées mais le mystère de leur pensée en actes. Ces gens sont photographiés pendant les entretiens mais ne posent pas pour moi, ils discutent avec Christiane en oubliant la plupart du temps qu’ils sont photographiés. Leur photographie montre ce triangle relationnel qui m’échappe, une manière de ne pas chercher à apparaître comme détenteur d’une vérité sur ces gens.
D’une manière générale, ce qui me sépare de Martha Rosler et du groupe de San Diego tient au fait que j’ai décidé depuis longtemps de me « battre » avec le seul outil de la photographie (bien qu’à une époque j’ai fait un peu de vidéo) qui reste un moyen assez modeste, très peu considéré dans l’art et sur le marché de l’art et dont tout le monde pense pouvoir s’emparer à des fins de création. Cette détermination vient aussi du constat de la dégradation progressive et continue de la culture photographique dans le grand public, ce qui n’était pas le cas lorsque j’ai débuté. Il y a donc pour moi une sorte de militantisme à défendre ce medium à la condition que ses effets ne soient pas une fin en soi. Au contraire, si j’ai titré mon livre Pour une photographie documentaire critique, c’est pour paraphraser le groupe de San Diego qui défendait une photographie politique, et pour insister maintenant sur la question critique. Le néolibéralisme nous fait vivre dans des crises permanentes et récurrentes, annihilant souvent les possibilités critiques du public par la peur générée, laissant croire que le refuge dans les affects intimes est la bonne solution. Je cherche par ma position à rendre à ce public la possibilité d’exercer son esprit analytique plutôt que d’être seulement soumis à ses émotions. Cela passe par le montage, des photographies entre elles, des photographies avec le texte, etc. et par les propositions de monstrations sous forme de livres, d’affiches, d’expositions, de projection parlée, de conférences, de rencontres, de workshops et d’enseignement.
E.J : Fonder le commun sur la praxis de ceux qui participent à l’activité commune même s’ils viennent d’horizons différents avec leurs différents systèmes de valeur (p 51), vous montrez comment cela fonctionne dans les situations d’urgence. Mais si cette activité crée de la greffe entre personnes et univers, une multitude d’autres choses peuvent les délier. Pensez-vous que les facteurs culturels, la langue, la religion, etc, sont toujours secondarisés grâce au processus d’un projet collectif ? Ne finissent-ils pas toujours par revenir ?
C.V / P.B : Le rapport au commun ne fonctionne pas seulement en situation d’urgence. Et je dirais plutôt que l’urgence est, dans bien des cas, un motif de dévastation du commun. Elle peut créer des synergies temporaires (comme on le voit, par exemple, dans des cas de catastrophe naturelle où les secours vont affluer venant de secteurs différents) ; mais la question du commun est très au-delà (et d’abord très en-deçà, en termes de fondation) de ces synergies. Dans les pages que tu cites, le mot important est bien plutôt celui d’activité : c’est l’agir collectif qui produit du commun. Et cet agir collectif, on peut voir, dans tous les espaces associatifs où nous sommes allés, qu’il est très largement multiculturel. Partout, en particulier où les personnes en situation de migration sont concernées (sauf, bien sûr, dans les lieux d’encampement officiel des OIG ou des pouvoirs politiques, qui sont des espaces largement policiers, où la puissance d’agir des concernés est annihilée), le pluriculturalisme actif est une évidence : c’était le cas à l’Hôtel City Plaza à Athènes, lieu d’hébergement alternatif ; c’était le cas également au camp autogéré de Pikpa, où la dimension multiculturelle se traduisait en particulier par la cuisine décidée en commun et faite en commun. Dans tous ces cas, il n’est en aucun cas question d’évacuer les différences (ou les divergences), mais de faire au contraire qu’elles puissent cohabiter. Cela ne va évidemment pas de soi lorsqu’il s’agit de communautés culturelles qui sont en conflit les unes avec les autres sur leurs propres territoires d’origine. Mais partout où les divergences ne sont pas intentionnellement attisées (par le manque du nécessaire ou par les manipulations policières), la cohabitation devient très vite un authentique motif de convivialité. Qu’il y ait par ailleurs non pas un retour, mais une présence permanente des différences est une évidence. On peut en tirer des motifs de dissension, ou des occasions de renouveler ses propres approches.
E.J : Tu donnes la parole à un témoin du mouvement de la nouvelle gauche qui émergea entre 73 et 80 (p 83, 84) et qui aura tenté d’éduquer les citoyens à un autre rapport au collectif. Mais ce mouvement aurait été ruiné par une gauche au pouvoir qui aura joué le jeu de la consommation. On peut se demander si la consommation n’est pas plus puissante en ce qu’elle est prise dans une technologie de pouvoir mondial qui anime le capitalisme et qui produit les subjectivités, un phylum machinique dirait Guattari, sauf à se replier dans des modes d’existence marginaux. Avec le Chiapas au Mexique, Jérôme Baschet que nous avions invité à une soirée de Chimères, nous a décrit une greffe réussie entre un système collectiviste ancestral et un État contemporain, mais il a souligné aussi que les jeunes quittent parfois leurs traditions pour la société libérale. Même si, avec la résistance aux injonctions du capitalisme, le mouvement se fait aussi dans l’autre sens, peut-on réduire ces mouvements vers la société libérale à une mauvaise déterritorialisation capitaliste ? N’est-ce pas utopique de vouloir s’en disjoindre entièrement ?
C. V / P.B : Bon, c’est un peu compliqué, parce qu’il y a beaucoup d’éléments différents dans ta question. D’abord cette Nouvelle Gauche qui émerge au tournant des années 70 va avoir bien peu d’occasions de se manifester, puisque ces années correspondent à l’arrivée au pouvoir du régime fasciste des Colonels, qui dure de 1967 à 1974. Et l’idée de produire des espaces sociaux alternatifs est battue en brèche par la violence de la répression politique. Les actions sont clandestines et le mouvement n’a pas l’assise sociale et populaire que peuvent revendiquer les communistes, qu’ils soient affiliés à l’internationale du post-stalinisme soviétique ou qu’ils en soient dissidents (ceux qui s’appelleront à partir de 1968 « parti communiste de l’intérieur »). Entre 1974 et 1981, c’est la droite qui détient le pouvoir, par bien des aspects proche de l’extrême droite, qui a été discréditée par la chute des Colonels mais continue d’agir en sous-mains. Pendant toute cette période, les persécutions se poursuivent – à plus bas bruit que précédemment, mais de manière effective, en particulier par les discriminations au travail inscrites dans le droit – contre tout opposant politique lié de près ou de loin (y compris par ses attaches familiales) à la gauche ou au mouvement social. La guerre civile, qui a produit le massacre des opposants par le pouvoir fasciste entre 1945 et 1949, et s’est achevée par la victoire de celui-ci grâce à l’aide du pouvoir américain (comme on l’a vu tout à l’heure) est terminée. Mais la violence politique anticommuniste et antisociale, dans une logique de guerre froide, se poursuit. Ce qu’on appelle « société de consommation », comme l’a fort bien analysé Marcuse, est intrinsèquement lié à cette rivalité de guerre froide. Mais la Grèce demeure, jusqu’aux années 80, un pays pauvre avec de très forts clivages sociaux et des structures économico-politiques fondamentalement clientélistes. Quand le représentant du clientélisme de droite cède le pouvoir en 1981, il le cède à un technocrate formé aux Etats-Unis, fils de celui qui a pactisé avec les Anglais à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour exterminer les représentants de gauche au sein de l’armée grecque. Le Pasok, fondé en 1974 après la chute des Colonels, prétend donc proposer une alternative de gauche alors qu’il promeut au contraire une société consumériste. Sa position est clairement antifasciste, mais pas pour autant antilibérale.
Ce n’est donc pas le mouvement alternatif qui est « ruiné par le pouvoir », car lui-même se situe hors de ce jeu politique des années 80-90. Et on ne peut pas attendre d’un pouvoir politique qu’il favorise les alternatives. Le pouvoir du Pasok, en tout cas, n’a pas exterminé ses opposants. Et le mouvement alternatif de la Nouvelle Gauche se situait parmi ces opposants.
Après les années 90 et la chute des blocs, on se trouve confrontés à une accélération considérable des processus de globalisation, et à la mise en œuvre au niveau mondial du « There is no alternative » du néolibéralisme thatchérien. Tu poses la question : « N’est-il pas utopique de vouloir s’en disjoindre entièrement ? » Je poserais plutôt la question à l’inverse : « N’est-il pas irréaliste de vouloir pactiser avec un système de gouvernementalité qui vise à l’éradication de toute socialité possible » ? Et ce qui me paraît de plus en plus évident est l’irréalisme total des mesures qu’on prétend imposer au nom du « réalisme » économique.
Pour reprendre l’exemple du Chiapas que tu évoques, il ne s’agit nullement d’une expérience « marginale », mais de la constitution d’une expérience politique d’autogouvernement d’un État parallèle à l’État national discrédité. Et bien sûr qu’entre les deux, demeurent des voies de passage de l’un à l’autre.
La situation est très différente en Grèce, où les mouvements alternatifs sont eux-mêmes très divers. Mais le fait est que la violence économique est nécessairement un facteur de discrédit jeté sur le pouvoir politique. Et beaucoup sont poussés à la contourner en choisissant des modes de vie qui s’apparentent à ce que la Nouvelle Gauche a tenté de promouvoir à partir des années 70. Cette filiation crée une grande porosité intergénérationnelle, en particulier sur les îles, à la fois plus abandonnées, et de ce fait même plus à l’abri du pouvoir central.

Christiane Vollaire : Comment situez-vous, dans leur ancrage historique, les formes contemporaines d’un devenir révolutionnaire ?Hamit Bozarslan : En 2011, les configurations révolutionnaires qui avaient vu le jour (...)

